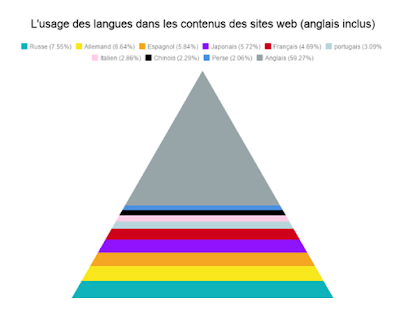* * *
Malgré de grands discours académiques se voulant toujours rassurants sur une transition facilitée entre universités et univers professionnel, je constate pour ma part une dichotomie plus que jamais présente entre ces deux mondes, l’un offrant maints diplômes
théoriques à des milliers d’étudiants qui, dans la
pratique, se retrouvent bien souvent sans travail sur l'autre, au terme de leur cursus universitaire, ou encore incapables de répondre à cette simple question : «
Et maintenant, par où je commence ? »
Dans un ouvrage intitulé «
La formation aux écrits professionnels : des écrits en situation de travail aux dispositifs de formation », coordonné par Mesdames Isabelle Laborde-Milaa, Sylvie Plane, Fanny Rinck et Frédérique Sitri, les auteures observent dans leur présentation :
Les relations université/monde professionnel sont fréquemment placées sous le sceau d'une dichotomie simpliste « théorie/pratique » qu'il faut dépasser. (...) Mais, comme le souligne l'un des intervenants, l'université ‒ et c'est sa raison d'être ‒ peut aider les entreprises à mieux comprendre...
Je suis quant à moi de l'opinion qu'au contraire, c'est le monde professionnel qui pourrait aider les universités à mieux appréhender la nécessité urgente de dépasser cette dichotomie, moins simpliste que réelle, pour favoriser un passage indolore des étudiants entre ces deux univers : une
transition préconisée de tous les côtés, mais peu appliquée !
* * *
En avril 2017, j'ai eu l'occasion de participer au
1er Congrès Mondial de Traductologie, organisé à l'université Paris-Nanterre. Voir ici
ma présentation, qui s'accompagnait d'une contribution écrite, soumise à évaluation pour publication éventuelle dans la monographie à paraître autour de cet événement.
Six mois après la soumission de mon texte, la réponse vient de tomber :
Cher collègue,
Nous avons le regret de vous faire savoir que votre article n'a pas été retenu pour publication. Vous trouverez ci-joint le rapport d'évaluation établi en aveugle à son sujet.
Le comité éditorial
Or la lecture de ce rapport d'évaluation, qui motive son refus de
mon article en trois paragraphes, est très instructive. Je vais tenter d'y répondre, paragraphe par paragraphe.
Premier paragraphe
Ce texte analyse les doubles contraintes de la traduction commerciale et les stratégies à mettre en œuvre (avec la notion de « story telling », reprise de Christian Salmon) pour y répondre au mieux. L’ensemble ne porte pas sur la traduction elle-même, encore qu’il touche à un non-dit de ce secteur, la dimension commerciale, et qu’il ne serait pas inutile à un public de personnes visant peut-être cette activité comme futur métier. Pour se placer sur son propre terrain, on remarquera cependant que tel qu’il se présente, l’article semble partagé entre les deux objectifs retenus (description et stratégies) en laissant le lecteur opérer lui-même la synthèse entre les deux, le résumé ne retenant quant à lui que le premier.
La première expression qui m'interpelle, fortement, est celle de «
traduction commerciale », pour moi totalement incompréhensible. Or l'évaluateur utilise en trois paragraphes quatre fois l'adjectif '
commercial': deux fois «
traduction commerciale », une fois «
traducteur commercial », et une fois «
dimension commerciale », explicitée comme un «
non-dit » du secteur de la traduction !
Ce simple constat (sur lequel je n'ai aucune envie de m'étaler pour l'instant, bien qu'il y aurait beaucoup à en dire) témoigne selon moi de l'éloignement sidéral d'un universitaire par rapport à la réalité du métier qu'il serait censé enseigner ! À moins qu'il ne se contente d'enseigner une discipline, et non pas un métier... Ce qui est d'ailleurs tout l'objet de mon "
article" :
puisque cela semble corroborer le fait que
la formation universitaire enseigne à « être traducteur » plus qu’à « être un professionnel de la traduction »...
Ce qui est fort dommage pour les étudiants lorsqu'ils quittent l'université !
Quant à la notion de « story telling » dont je parle, elle n'a absolument plus rien à voir avec celle introduite par Christian Salmon en 2007, tel que je l'indique :
Initialement conçue pour propager des histoires d’entreprise en privilégiant une complicité émotionnelle avec leurs clients, afin de « réenchanter » la ou les marque(s), elle a beaucoup évolué en dix ans, notamment en se personnalisant.
Adaptée à notre niveau, elle consiste à se raconter, à être le conteur de soi-même. Concept traduit en français par « communication narrative » ou « communication créative », sa finalité est de capter l’attention d’un public pour partager (voir plus haut l’étymologie de « communiquer ») une histoire avec lui, le convaincre, voire le séduire.
« Les êtres humains souhaitent communiquer pour trois raisons. Partager. Convaincre. Séduire. Et très souvent pour les trois simultanément. » (Dominique Wolton).
Je continue : «
L’ensemble ne porte pas sur la traduction elle-même... » Et il porte sur quoi ? Certes, selon mon titre, il porte tout particulièrement sur «
l'exercice des métiers de la traduction », mais n'est-ce pas toujours de traduction dont il s'agit ? Mon métier c'est de traduire. Plus de 80 000 pages traduites de l'anglais et de l'italien vers le français en trente-trois ans de carrière. Sans compter l'interprétation. Trois décennies passées que je gagne ma vie en traduisant. Et selon l'INSEE, mon activité principale exercée est bien la traduction (code APE : 7430Z).
Probablement devrions-nous nous entendre sur la signification du terme
traduction, dont le premier sens est :
action de traduire ; résultat de cette action.
Est-ce cela que vous enseignez à l'université, cher évaluateur ? Et si vous répondez par l'affirmative, pourquoi l'enseignez-vous ? Pour la beauté de l'art ? Ou serait-ce parce que les étudiants censés tirer profit de votre enseignement fréquentent vos amphithéâtres dans la perspective de vivre un jour de ce qu'ils auront appris de vous ? Ce serait à se demander si vous vous êtes déjà posé la question du pourquoi vous enseignez !
Oh ! [L'ensemble]
ne serait pas inutile à un public de personnes visant peut-être cette activité comme futur métier. Voilà qui est dit, donc.
Peut-être...
Quant à la conclusion du paragraphe :
Pour se placer sur son propre terrain, on remarquera cependant que tel qu’il se présente, l’article semble partagé entre les deux objectifs retenus (description et stratégies) en laissant le lecteur opérer lui-même la synthèse entre les deux, le résumé ne retenant quant à lui que le premier.
il serait bon de rappeler qu'en vue de la publication, le texte, inédit, ne devait pas dépasser «
30 000 caractères espaces compris au maximum », et qu'il m'a donc été impossible de développer les stratégies comme je l'aurais souhaité. Ceci dit, elles étaient mieux explicitées dans
ma présentation, ces deux documents étant complémentaires.
* * *
Deuxième paragraphe
L’ensemble se présente ainsi comme une sorte de vade-mecum du traducteur commercial, écrit dans la langue d’un spécialiste des stratégies de construction d’une image de marque individuelle, et donc de conquête des faveurs d’une éventuelle clientèle. Il utilise un vocabulaire spécialisé qui n’est pas toujours explicité (« curation »). En fait, l’objectif est plus étroitement centré encore par son orientation vers les pratiques de communication sur internet. De là aussi le langage, et les formes d’écriture propres au billet, ou plus largement au blog, que l’auteur pratique par ailleurs. Ce qui explique les nombreux points de suspension, les crochets carrés, les paragraphes courts (parfois même paragraphes-phrases), ainsi que d’autres aspects techniques, mais surtout l’absence de références précises concernant les textes cités (de Darwin, Wolton, Branson, Jarvis et Godin), et le fait que la bibliographie renvoie presque intégralement à des sites internet. Le langage et le style correspondent à ce type d’échange, et visent à maintenir le contact avec un lecteur peut-être prompt à passer à un autre texte à la moindre difficulté de déchiffrage.
Idem : que veut dire
vade-mecum du traducteur commercial ? Passe pour le
vade-mecum du traducteur,
de l'expert traducteur et interprète, ou encore pour celui
relatif à l'usage de la langue française dans les organisations internationales, mais du traducteur commercial !
Écoutons M. Daniel Gouadec, qui écrivait ceci dans son livre,
Profession : traducteur (première édition fin 2002, réédité jusqu'en 2010), à propos de ce
profil professionnel :
1.2.3 Traducteur commercial
Le traducteur commercial traduit des documents commerciaux : factures, contrats, documents de transport, instruments douaniers, etc.
En France, il a longtemps existé un diplôme de traducteur commercial désormais tombé en désuétude. Il s'agissait de valider chez les postulants une vague compétence de traduction dans le domaine économico-commercial et de définir un " titre " permettant de singulariser les assistants commerciaux soucieux de valoriser leurs aptitudes linguistiques.
Le traducteur commercial a disparu avec la mise en place de formations et de diplômes nationaux de traducteurs.
Tombé en désuétude dès 2002 ! Il est vrai qu'on trouve encore un
master Traducteur juridique et commercial à Lyon, mais je peux vous assurer que dans le métier, entre collègues, je n'ai jamais entendu personne se définir comme traducteur commercial ! Ça ne correspond à aucune réalité professionnelle et, pour paraphraser M. Gouadec, je dirais que le traducteur commercial «
est ce qui reste lorsque l'on a retiré le traducteur littéraire, le traducteur [technique], le traducteur scientifique, le traducteur biomédical, le traducteur juridique, le sous-titreur, le surtitreur, le localiseur, le traducteur expert judiciaire (...), le traducteur audiovisuel et le traducteur de produits multimédia. »
Personnellement, je trouve cette utilisation de "traducteur/traduction commercial(e)" à la limite de la condescendance, et quoiqu'il en soit fortement dévalorisante pour notre profession, soit le contraire exact de
ce que devraient faire tous les intervenants impliqués de près ou de loin dans ce métier, formateurs compris.
Venons-en à mon emploi d'un
vocabulaire spécialisé qui n’est pas toujours explicité (« curation »), d’
absence de références précises concernant les textes cités (de Darwin, Wolton, Branson, Jarvis et Godin), et du
fait que la bibliographie renvoie presque intégralement à des sites internet.
Une critique irrecevable dès lors qu'il n'y a pas lieu d'expliciter des termes censés être connus en 2018, ou que mes références bibliographiques ne concernent pas des ouvrages classiques (exception faite pour Darwin, or y a-t-il encore
quelqu'un qui ignore «
Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux changements », sérieusement ?), mais quasi-exclusivement des textes créés pour et sur Internet ?
Quoi qu'il en soit, je ne vois pas à quel titre cela autoriserait l'évaluateur à inférer que mon lectorat serait
peut-être prompt à passer à un autre texte à la moindre difficulté de déchiffrage ! Là encore, une condescendance hors de propos...
* * *
Troisième paragraphe
On imagine que cet article trouverait sa pleine place dans un manuel visant à éclairer, avertir et guider les jeunes praticiens de la traduction commerciale. Il serait sans doute éclairant pour eux, mais semblerait en décalage par rapport aux autres articles, plus scientifiques, de la future publication... De ce fait même il ne correspond pas au profil visé par ce recueil. Il me semble donc difficile de le retenir pour cette monographie. Il demanderait par ailleurs un toilettage pour en gommer les aspects formels renvoyant à l’écriture telle qu’elle tend à se pratiquer dans certains domaines internet, mais qui n’est pas toujours conforme à ce qu’on attend d’un article de recherche.
Nous voici donc au cœur du problème :
mon texte dénote
par rapport aux autres articles, plus scientifiques, de la future publication, rédigé dans une
écriture telle qu’elle tend à se pratiquer dans certains domaines internet, mais qui n’est pas toujours conforme à ce qu’on attend d’un article de recherche.
OK, OK, peut-être aurait-il mieux valu commencer par là ! Il suffisait de le dire d'emblée, aucune nécessité de s'enliser dans un rapport d'évaluation qui tombe à côté de la plaque. Il y a trois ans déjà,
l'un de mes textes n'avait pas été retenu pour publication dans une revue "sérieuse", j'imagine pour le même genre de motivations.
Pour autant, ce qui me chagrine dans cette situation, c'est qu'à force de vouloir à tout prix écrire des articles "scientifiques" conformes à ce qu'
on (
qui ?) attend d'articles de recherche, notre profession souffre d'un déficit chronique de valorisation...
Quant aux étudiants qui terminent leur parcours universitaire et obtiennent leur diplôme, eux aussi attendent de leur recherche qu'ils trouveront du travail : or la formation qui leur aura été dispensée pendant les années d'université suffira-t-elle pour qu'ils sachent comment se lancer dans le métier avec tous les atouts en main ?
La réponse aux évaluateurs de tout acabit...