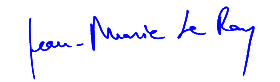Un trait, entre tous distinctif, oppose la civilisation contemporaine à celles qui l'ont précédée : la vitesse.
Paul Virilio (1932-2018)
*
Intelligence artificielle (les 4 blocs en PDF)
Premier bloc - Deuxième bloc - Troisième bloc - Quatrième bloc
*
Paul Virilio est un homme de notre temps, décédé il y a moins de dix ans. Dès la moitié des années 70, il fut le premier un théoricien de la « vitesse », dont il dénonça pendant 40 ans la tyrannie et les travers. Face à l'accélération du réel, disait-il, on n'a pas de philosophie pour penser ça.
Toutefois, bien qu'il l'ait prédit, je ne crois pas qu'il aurait imaginé l'accélération folle, exponentielle, à laquelle nous assistons au cours de cette dernière décennie, avec la rupture de la troisième révolution civilisationnelle due à l'intelligence artificielle ! Et nous n'en sommes qu'au début...
Dans une déclaration récente, Eric Schmidt (ex-CEO de Google) va encore plus loin : nous n'avons aucun langage (aucune langue ?) pour concevoir ni décrire ce qui va se passer (d'ici à moins de 10 ans...) (We have no language for what’s coming).
Personnellement, je suis un utilisateur assidu des ordinateurs et d'Internet depuis une trentaine d'années, or j'ai une répulsion instinctive vis-à-vis des téléphones portables, soi-disant intelligents, ces envahisseurs espions qui pénètrent notre existence chaque jour davantage. Ce qui me vaut d'ailleurs les moqueries de mon fils. Mais je n'en ai cure. Nos espaces de liberté se réduisent comme peau de chagrin, s'il y en a encore un peu, je ne vendrai sûrement pas ce qui me reste pour un plat de lentilles !
Gigantesque est le fossé, qui se creuse à chaque instant, entre la célérité de propagation de mille technologies dans nos vies, et la lenteur dont l'être humain a besoin pour assimiler les changements, pour donner du sens aux ruptures, à la fois personnelles et professionnelles, ou pour élaborer les douleurs et les souffrances (voire pour faire son deuil lorsque cela est nécessaire), qui émaillent notre parcours sur cette terre.
Confrontés à l'impossibilité ontologique de combler ce fossé, chacun de nous est appelé à mettre en œuvre ses propres stratégies, adopter (et adapter) une approche prospective pour explorer son avenir possible, et le construire étape par étape. Ce n'est jamais quelque chose que l'on bâtit dans la hâte. Cela doit s'inscrire dans un espace-temps humain (et non pas artificiel), réel (et non pas virtuel). Nos sens exigent du temps pour se développer. Plusieurs années passent avant que le bébé ne devienne l'enfant.
La vitesse n’est plus un simple paramètre technique, mais un facteur structurant de notre personnalité et civilisation, avec des implications profondes, politiques, culturelles, sociales (et notamment en termes de contrôle social, ou de « crédit social », pour employer une chinoiserie), voire militaires. Elle transforme notre rapport au monde, et donc au corps, à la présence, notre champ de vision se rétrécit. Elle altère notre perception des choses, abolit les repères physiques, l’espace géographique, « virtualise » le monde, le pollue à la fois physiquement (transports) et mentalement (stress, surcharge informationnelle).
Une bonne loi nécessite un temps de réflexion incompressible. Il en va de la sécurité juridique de nos concitoyens et du bon fonctionnement de la démocratie.
Si, en 1790, il fallait cinq musiciens pour interpréter un quintette de Mozart durant tant de minutes, aujourd'hui, en dépit des progrès techniques considérables qui ont été accomplis depuis, rien n'a changé : il faut toujours autant de musiciens jouant pendant autant de temps pour restituer la même œuvre !
Le temps humain n'est pas le temps des machines. Avant, le temps humain, c'était le passé, le présent, le futur. Aujourd'hui, c'est du 24/24, du 7 jours sur 7, c'est l'instantanéité. Ça explique combien il est difficile de vivre, de tout concilier... Il faut se laisser le temps de réfléchir, le temps d'aimer...