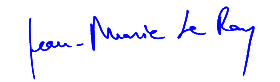[ Préface à mon dernier essai, intitulé De maillons faibles à maillons fiables : refonder le (monde du) travail à l'ère de l'IA ]
Je suis traducteur-interprète de métier depuis plus de 40 ans. Un jour
quelconque, en 2025, je vois apparaître en bas de l’interface d’un LSP, une phrase très brève, sobre, presque administrative, comme un élément de
langage parmi d’autres. Elle ne cherche pas à convaincre, encore moins à
impressionner. Elle se contente d’énoncer une évidence censée rassurer au
moment où l’on change les outils et les procédures, et où l’on demande à des
professionnels de faire confiance à un flux qu’ils n’ont pas conçu :
« You remain in control of the final product. »
Littéralement, vous avez le contrôle du produit final.
Je pourrais disserter longuement sur la traduction de cette phrase, tout sauf
simple, tant les non-dits dont elle est porteuse sont nombreux. Mais passons.
On la retrouve dans les formations, les guides d’utilisation, les
webinaires, les échanges avec les donneurs d’ordre. Elle a pour fonction d’apaiser :
malgré l’automatisation, malgré la réorganisation des workflows, malgré
des systèmes capables de produire plus vite, l’humain resterait au centre. Il
garderait la main, le dernier mot, bref, la responsabilité.
Et pourtant, tout commence précisément là. Non pas dans une grande annonce,
ni dans une rupture spectaculaire, mais dans cette formule répétée, banalisée,
installée dans le quotidien. On ne rappelle pas à quelqu’un qu’il continue d’avoir
le contrôle si rien n’a bougé. On ne rassure pas sur le dernier mot si l’essentiel
du texte n’est pas déjà écrit. On n’insiste pas sur la responsabilité finale
si, en amont, quelque chose s’est déplacé dans la chaîne.
Décrivons la scène d’une journée normale, qui commence comme les autres, et
pourtant ce n’est déjà plus tout à fait la même journée qu’il y a quinze ans,
qu’il y a dix ans, parfois même qu’il y a cinq ans. Les fichiers sont déjà là,
prêts à être traités. Ils ont été segmentés, analysés, préparés. Le projet a
une échéance, un volume, un tarif, un standard implicite, et ce standard, de
plus en plus souvent, est celui du « good enough » — suffisamment bon pour passer, pour livrer, pour que l’on n’y
revienne pas.
La première version existante a été générée automatiquement.
Le traducteur n’arrive pas devant un texte source qu’il doit reconstruire
patiemment, phrase après phrase, dans une autre langue. Il arrive devant un
texte cible, déjà là, qu’il doit stabiliser. Ce renversement a l’air minime —
après tout, il s’agit toujours d’un texte à lire, d’une langue à maîtriser, d’un
sens à faire tenir. Pour autant, cette nouvelle donne change totalement,
bouleverse même, le rapport au travail.
Dans les deux cas, je lis, je comprends, j’ajuste, j’écris. Mais dans un
cas, je construis ; dans l’autre, je corrige. Dans un cas, je maîtrise le
chemin ; dans l’autre, je juge un résultat. Dans un cas, le texte est une
matière qui résiste et que je façonne ; dans l’autre, le texte est une
surface déjà lissée (en apparence) que je dois contrôler, sécuriser, valider.
Le texte est globalement correct. Parfois même étonnamment fluide. Le sens
général est respecté, les structures tiennent, les phrases s’enchaînent. Ce n’est
pas un charabia. Ce n’est pas une suite de contresens grossiers. C’est aussi
cela qui rend la situation nouvelle : l’erreur n’est plus toujours un choc ;
elle devient une nuance perdue, une ambiguïté déplacée, un implicite mal
transposé, un registre légèrement faux. Le texte « passe », mais il n’est
pas fiable au sens où l’on attend qu’un document engageant — juridiquement,
commercialement, symboliquement — soit maîtrisé.
Il y a des glissements. Des approximations. Des contresens discrets,
parfois d’autant plus dangereux qu’ils ne sautent pas aux yeux. Il y a des
formulations « acceptables » qui sont faussées : un terme trop
générique qui affaiblit une obligation ; une modalité mal rendue qui
transforme une recommandation en promesse ; une phrase trop affirmative là
où le texte source ménageait une réserve. Et parce que tout est globalement
correct, la vigilance doit être totale : l’erreur n’est plus un signal, c’est
une possibilité diffuse qui se loge dans les interstices.
Le traducteur vérifie. Je remplace un mot, reformule une phrase, précise
une intention, rétablis une cohérence terminologique. Je fais ces gestes
minuscules qui, mis bout à bout, doivent transformer un texte « acceptable »,
mais incomplet, en texte fiable. Une activité chronophage. Un travail qui
demande une double attention continue (texte source et texte cible) et,
surtout, du jugement : je dois comprendre ce qui est dit, ce qui est déjà
« traduit », mais aussi ce qui est sous-entendu ; sentir ce qui
sonne juste et ce qui sonne faux ; repérer les erreurs qui n’ont pas la
forme d’erreurs. Autrement dit, je dois faire exactement ce que les systèmes
automatisés ne savent pas encore (et ne sauront probablement jamais)
faire de manière robuste : valider la fiabilité, garantir la qualité et en
assumer toute responsabilité.
« You remain in control of the final product. »
Rien de tout cela n’a disparu. La compétence est toujours là. Le besoin est
toujours là. Le métier, en apparence, existe encore. Mais quelque chose s’est déplacé : l’intervention humaine arrive plus tard dans le processus. Elle se
situe en fin de chaîne. Et quand on est en fin de chaîne, on n’hérite pas
seulement d’un texte : on hérite d’un rythme, d’une économie, d’une
organisation. On hérite de choix qui ont été faits ailleurs — choix de délai,
de coût, de seuil de qualité, de tolérance à l’imprécision — et l’on doit,
pourtant, endosser le résultat.
Pendant longtemps, la traduction a été un métier à part entière au plein sens
du terme. Le traducteur ne se contentait pas d’intervenir à la marge sur un
texte existant : il en maîtrisait la production de bout en bout. Il
recevait un document, en comprenait les enjeux, reconstruisait le sens dans une
autre langue, assumait chaque choix lexical, chaque nuance, chaque formulation.
La qualité du résultat dépendait directement de son travail, et cette
responsabilité totale allait de pair avec un contrôle total sur le processus.
Le lien entre compétence, production et responsabilité était direct, lisible,
cohérent : ce que l’on payait, ce n’était pas une « finition »,
c’était une construction.
Puis le modèle a commencé à se transformer, non pas brusquement, mais par
étapes. L’apparition de la localisation a marqué un premier tournant. Traduire
ne consistait plus seulement à transposer un texte, mais à l’adapter à des
marchés, à des contextes, à des contraintes techniques. Les projets se sont
structurés, les volumes ont augmenté tout en impliquant des délais raccourcis.
La traduction est entrée dans des chaînes de production plus larges, avec des
chefs de projet, des outils de mémoire, des bases terminologiques, des validations intermédiaires. Ce n’était pas
encore une rupture, mais c’était déjà un déplacement : d’artisanale, le
métier se branchait sur une logique industrielle.
Progressivement, le travail s’est fragmenté. Le texte a cessé d’être un
ensemble continu pour devenir une succession de segments. La production a été
découpée en tâches : préparation, extraction, alignement, traduction,
révision, contrôle qualité, intégration. Une part de la compétence s’est
déplacée vers des procédures ; une part de la qualité, vers des standards ;
une part du pilotage, vers des dispositifs. Le traducteur, autrefois
responsable d’un tout, est devenu un maillon parmi d’autres. Cette fragmentation
n’était pas en soi illégitime : elle répondait à des volumes, à des
contraintes, à des environnements techniques. Mais elle changeait une chose
essentielle : elle dissolvait la maîtrise globale du processus dans une
pluralité d’étapes dont personne ne possédait plus, à lui seul, la totalité.
Avec l’arrivée de systèmes de traduction automatique de plus en plus
performants, cette fragmentation a changé de nature. Une large partie de la
production s’est déplacée en amont. Le texte n’était plus seulement une matière
à transformer, mais une base déjà transformée, qu’il fallait corriger,
stabiliser, adapter. Le travail humain s’est concentré sur les derniers
pourcents : non plus produire de bout en bout, mais juste rendre
présentable et fiable.
C’est ici que le glissement devient visible dans sa dimension économique.
Là où la traduction était rémunérée comme un acte de production, la
post-édition est rémunérée comme un acte de finition (sans parler aujourd’hui
de post-éditer la post-édition automatique…). Dans de nombreux cas, la
rémunération s’est contractée jusqu’à représenter une fraction de ce qu’elle
était auparavant — parfois autour de trente pour cent du tarif initial :
là où j’étais rémunéré 100 €, je ne gagne plus que 30 € ; en clair, ce n’est
plus « je prends 30 », mais « j’en perds 70 ». Le
raisonnement semble simple : si la machine fait l’essentiel, l’humain ne
fait plus que « finaliser ». Et pourtant ce raisonnement inverse
souvent la réalité du risque : car l’essentiel, dans un texte qui engage,
n’est pas la production brute ; c’est la fiabilité du produit final.
Or ce qui frappe, c’est que la responsabilité, elle, n’a pas suivi la même courbe.
Le donneur d’ordre continue d’attendre un résultat final irréprochable. Le
texte est livré sous la responsabilité du traducteur. Si un contresens
subsiste, si une ambiguïté juridique se glisse dans un contrat, si une
formulation pose problème, c’est vers lui que l’on se tourne. Le système en
amont — les outils, le workflow, les arbitrages de coût et de délai, les
décisions de production — disparaît derrière la validation finale. La qualité,
dans les discours, devient un attribut du système, largement vendu dans l’argumentaire
marketing ; dans les faits, elle reste une obligation du professionnel.
La logique est claire, même si elle n’est jamais formulée ainsi : la
production est industrialisée, la valeur est fragmentée, mais la responsabilité
est concentrée.
C’est ici que la phrase prend son sens véritable : « You
remain in control of the final product. »
Elle dit : vous gardez le dernier mot. En vrai, elle signifie :
vous gardez juste la responsabilité.
Or il peut y avoir un abîme entre « dernier mot » et « contrôle ».
Car le contrôle, au sens fort, ne se réduit pas à pouvoir corriger. Le
contrôle, c’est maîtriser le processus : connaître les conditions de
production, avoir le temps d’examiner, pouvoir remonter en amont, refuser un
flux, exiger une clarification, négocier un standard, choisir un niveau de
qualité. Le « dernier mot » peut n’être en aval qu’un geste de
validation sous contrainte — un oui ou un non prononcé à la fin d’une
chaîne dont on ne modifie ni la vitesse, ni l’économie, ni la logique.
Et c’est là qu’apparaît une position très particulière, et profondément
moderne (quand bien même la modernité, ici, ne rime pas avec le progrès). Le
professionnel devient à la fois moins central dans la production et plus
central dans la responsabilité. Il se retrouve chargé de garantir un résultat
qu’il ne produit plus entièrement, et presque toujours sans disposer des moyens
nécessaires pour le garantir sereinement, ni en temps ni en argent. Il devient
l’interface humaine d’un processus qui, pourtant, ne dépend plus uniquement de
lui : on attend de lui la qualité finale, mais on lui retire une partie
des conditions qui permettent de la construire.
Cette position, ce prologue la désigne par une image : le fusible.
Un fusible n’est pas inutile ; il est indispensable. Il protège l’ensemble.
Il absorbe les tensions. Il évite les surcharges. Mais il est aussi, par
définition, la pièce la plus exposée : celle qui cède en premier lorsque
quelque chose dysfonctionne. Le fusible n’est pas marginal ; il est
critique. Et c’est justement parce qu’il est critique qu’il est sacrifiable.
Tant qu’il tient, le système fonctionne ; lorsqu’il cède, on parle d’erreur
humaine — et l’on oublie, souvent, tout ce qui a précédé.
Dans la traduction, le fusible est visible à nu : rémunération
fragmentée, responsabilité concentrée. Le professionnel n’est plus payé pour
produire de bout en bout, mais il est tenu d’assumer de bout en bout. Il ne
contrôle plus toutes les étapes, mais il porte le risque final. Ce qui s’y joue
n’est pas une anecdote sectorielle : c’est une forme organisationnelle.
Une manière de produire du « suffisamment bon » en industrialisant la
production, puis en reportant la charge de fiabilité sur l’humain en bout de
chaîne.
Ce livre ne part pas d’une théorie générale, mais de ce déplacement concret :
une responsabilité maintenue, souvent accrue, alors même que les conditions de
maîtrise du processus se fragmentent. À partir de ce point, il devient possible
de relire autrement la grande promesse des révolutions technologiques — et de
poser une question plus large : comment refonder la place de l’humain
lorsque son rôle se déplace vers la fiabilité, et lorsque la solidité de l’ensemble
dépend de ceux qu’on traite pourtant comme s’ils n’étaient en charge que d’une
simple « finition » ?
Le terme même de « finition » paraît anodin. Il suggère ce qui
vient après l’essentiel, ce qu’on ajoute une fois le travail principal accompli :
un polissage, un ajustement, une retouche. Dans l’imaginaire industriel, la
finition est une étape périphérique, presque cosmétique, qui n’affecte pas la
structure profonde de l’objet. Du reste, le mot porte souvent une connotation
péjorative : celle du cache-misère, de l’artifice qui permet de rendre
présentable un produit dont la qualité (si elle existe) aurait été construite
ailleurs.
Or cette représentation est extrêmement trompeuse, voire dangereuse,
lorsque le cœur du travail se déplace vers la validation. Dans les métiers où
un livrable engage réellement — par ses effets, ses conséquences et la
responsabilité qu’il entraîne —, la « finition » n’est pas un
supplément. Elle est la condition même de la fiabilité. Elle n’ajoute pas de l’esthétisme,
elle retire du risque. Elle ne « peaufine » pas un résultat, elle en
garantit la solidité. C’est à ce moment-là que se décident la justesse d’un
terme, la portée d’une formulation, la cohérence d’un raisonnement, l’absence d’ambiguïté
— autrement dit, tout ce qui fait qu’un document peut être signé, transmis,
opposable, assumé, ou qu’un produit peut être livré.
Mais le problème n’est pas seulement sémantique, il est également
économique. Car le niveau de rémunération accordé correspond exactement à cette
définition dégradée de la « finition ». Si l’on considère que l’essentiel
est fait en amont, alors ce qui reste en aval ne peut être, par construction,
qu’une intervention marginale. On paie donc cette étape comme une retouche, un
ajustement, un travail de surface. Le prix traduit une tâche résiduelle,
rapide, presque accessoire.
Mais cette représentation inverse la réalité du risque. Car ce qui engage
véritablement la responsabilité ne se joue pas dans la production brute, mais
dans la validation finale. C’est à cet endroit que l’erreur devient faute, le
produit vicié, l’approximation responsabilité, ou que le texte devient acte. Le
système peut produire 95 % du volume ; c’est dans les 5 %
restants que se décide la fiabilité réelle (l’annexe B approfondit ce
point en montrant pourquoi la logique volumétrique du « 95/5 »
constitue une illusion de perspective et comment elle conduit à sous-estimer la
fonction décisive de la validation humaine).
Il se crée ainsi un décalage structurel : la rémunération est alignée
sur l’idée d’une simple retouche finale, alors que la responsabilité, elle,
reste alignée sur l’exigence d’un travail complet et parfait. On paie comme si
l’on intervenait à la marge ; on exige comme si l’on maîtrisait l’ensemble.
Ce décalage, profondément injuste, est également structurant : il installe
l’idée que la garantie humaine est un supplément peu coûteux, alors même qu’elle
est devenue la condition de durabilité du système.
C’est donc là que se noue le malentendu initial.
En effet, ce que l’on qualifie encore de « finition », par
habitude, s’impose désormais comme la clé de voûte de la fiabilité de nos
systèmes actuels. Pourtant, faute de mots justes pour la nommer et la reconnaître,
celles et ceux qui l’exercent sont réduits au rôle d’exécutants de détail. En
réalité, alors même qu’ils garantissent la solidité de l’édifice, ils se
retrouvent traités comme des variables d’ajustement, en l’occurrence de simples
fusibles, les « maillons faibles » du présent essai.